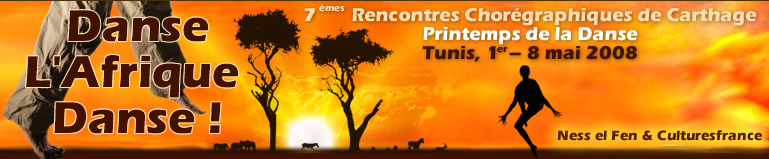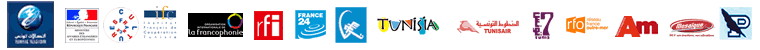Depuis sept ans déjà, « l’âge de raison » dit-on, les « Rencontres Chorégraphiques de Carthage » (RCC) créées par l’association Ness el Fen s’attachent à faire partager au public tunisien l’expression chorégraphique contemporaine, à travers ses formes les plus diverses, des plus accessibles aux plus exigeantes, dans une volonté de sensibiliser le regard à cette création artistique, d’installer une « culture » de la danse contemporaine.
Adossé dés l’origine à L’Ecole d’initiation et de perfectionnement à la danse que dirige par ailleurs l’association (prolongée depuis 2007 par le Centre méditerranéen de danse contemporaine), le festival a toujours eu pour objectif, par-delà la promotion et la circulation des oeuvres et des artistes, d’encourager et de soutenir l’essor de la danse contemporaine en Tunisie comme dans la région.
Le projet des « Rencontres Chorégraphiques de Carthage » naît en 2001, lorsque les "Repérages", réseau de programmateurs qui oeuvrent à la circulation de jeunes chorégraphes, organise sa résidence à Tunis, pour la première fois dans un pays du Maghreb à l'initiative de l'association Ness el Fen. L'intention est de favoriser des échanges, des projets croisés entre chorégraphes et entre professionnels.
Dés l'année suivante, en 2002, l'association Ness El Fen met en place le festival, sous-titré Le Printemps de la Danse, entièrement dédié à la danse contemporaine.
Il ne possède pas encore des bases très affirmées, mais ses grands traits sont là : une représentation des divers courants de l'expression chorégraphique contemporaine, un soutien aux danseurs tunisiens, un public curieux, composé de jeunes en grande majorité, et déjà un effort pour susciter rencontres et échanges professionnels. Une vingtaine de pièces sont données à Tunis, en provenance d'une dizaine de pays, sélectionnées en particulier parmi les créations de jeunes chorégraphes (1).
Avec l'édition 2003, le festival prend de l'ampleur, réalise un vrai saut qualitatif, tant sur les plans de la programmation générale que de l'organisation.
Le festival se veut lieu de débats, de présentation et de rencontre des réseaux, des professionnels et des artistes, pour engager une réflexion approfondie sur l'état actuel de la danse dans la région, pour proposer des perspectives de pratiques professionnelles fiables. Une plate-forme est insérée pour soutenir et promouvoir la jeune création tunisienne, et l'Afrique sub-saharienne trouve une place privilégiée (2). Une relation de travail est nouée avec le festival de danse africaine contemporaine organisé par l’AFAA (Association française d’action artistique) à Antananarivo (Madagascar) : les « Rencontres Chorégraphiques de l'Afrique et de l'Océan indien ».
Le public a grandi, l'organisation se « professionnalise », le festival gagne des partenaires supplémentaires convaincus par sa pérennisation. Les « Rencontres Chorégraphiques de Carthage » s'installent dans le paysage culturel et artistique tunisien.
Les éditions 2004 et 2005 des RCC ont capitalisé ces premières expériences.
De plus en plus, Tunis s'affirme comme un des rendez-vous chorégraphiques majeurs du continent, soutenant le dialogue des cultures par le biais de la circulation des oeuvres, trouvant place dans le mouvement international de la création artistique contemporaine.
Le festival est plus résolument encore "adossé" à la formation, approfondit les ateliers avec les chorégraphes invités, permet aux écoles de danse contemporaine du pourtour méditerranéen de se réunir et de se connaître. Des modules de spécialisation sont proposés aux journalistes culturels et un journal du festival est publié (Dihy Chaussé).
Pour valider et formaliser les liens qui se tissent, un réseau panafricain de danse contemporaine est crée, Chesafrica, réunissant professionnels, structures et festivals (3), dans le but de favoriser la transmission des informations et des expériences, la découverte et la diffusion des artistes et des oeuvres, et de participer au renforcement des compétences dans les domaines de la formation, du management culturel et des métiers du spectacle.
De nombreux chorégraphes européens, parmi les plus réputés de la scène internationale, sont présents à Tunis au cours de ces deux éditions de la maturité et de « l’enracinement » du festival (4), avec toujours une présence très large et encore accentuée du Maghreb (5) et de l'Afrique sub-saharienne (6).
A partir de 2006, les RCC se placent sous le signe de thématiques particulières.
Au cours des premières éditons, il s’agissait de faire une place à la danse sur la scène artistique nationale, de la doter d’un réseau de partenariat actif, d’inscrire l’évènement dans l’actualité culturelle, d’insuffler une dynamique à la création chorégraphique en sensibilisant les institutions et en impliquant les professionnels.
L’autre objectif fondamental des RCC était et reste d’ordre pédagogique. Il fallait faire connaître, faire comprendre pour faire aimer, une forme d’expression longtemps méconnue, volontiers jugée difficile d’accès, voire détachée des réalités artistiques locales. Un volet pédagogique indissociable des efforts pour soutenir la formation et intéresser de nouveaux partenaires à son bénéfice.
L’édition 2006 est centrée sur les rapports et les correspondances entre « danse traditionnelle » et « danse contemporaine ». Encourageant la confrontation et le dialogue des œuvres et des artistes en provenance d’Europe, d’Afrique du Nord et Sub-saharienne, d’Asie également, cette édition installe des passerelles, propose de dépasser l’opposition parfois entretenue entre le devoir de mémoire et l’aspiration à la modernité (7).
En 2007, les RCC investissent un phénomène de société quasi universel, la « danse urbaine » Vaste mouvement culturel, la « danse urbaine » a essaimé à travers le monde et s’est imposée comme phénomène social et artistique à part entière, dont le passage de la performance « de rue » à la scène a enrichi la danse contemporaine et fécondé de nouvelles écritures chorégraphiques (8).
Le festival est toujours relié à la formation, et l'Ecole de danse de l'association Ness El Fen donne naissance au « Centre Méditerranéen de Danse Contemporaine » (CMDC) à vocation professionnelle, qui accueille sa première promotion en janvier 2007. L’enjeu est d’importance, puisqu’il en va de la « territorialisation » de la formation artistique sur le continent.
En 2008, les RCC et l’association Ness el Fen accueillent les « Rencontres chorégraphiques de l’Afrique et de l’Océan indien », Danse l’Afrique danse !
En accueillant cet événement biennal organisé par Culturesfrance (ex-AFAA), pour son retour en Afrique après un passage par Paris, Tunis inaugure la nouvelle formule de cette manifestation voulue désormais itinérante sur le continent. Le choix de Tunis consacre et valorise le positionnement et la réalité internationale des « Rencontres chorégraphiques de Carthage », à qui la direction artistique et logistique de cette édition est confiée.
A la faveur de son histoire, de sa situation géographique, de son identité culturelle, la Tunisie est située au centre du Bassin méditerranéen, au cœur du Monde Arabe, à la croisée de l’Europe et de l’Afrique sub-saharienne : les RCC ont toujours voulu privilégier ce positionnement exceptionnel, au carrefour des civilisations, au croisement des communautés.
Ainsi cet événement en 2008 a-t-il aussi pour ambition de resserrer les liens entre professionnels et artistes du continent, de dégager les perspectives d’une nouvelle dynamique au service du développement et de la consolidation continentale de la danse contemporaine. L’aventure continue, donc… Avec la complicité et le soutien d’un public fidèle, toujours plus nombreux et convaincu.
www.nesselfen.org
www.printemps-danse.planet.tn
www.cmdc.nesselfen.org
-----------------------------------------
(1) Cela se traduit ainsi, entre autres, par les présences de Héla Fattoumi et Eric Lamoureux, d'Abou Lagraa, de Pedro Pauwels (des fidèles que l'on retrouvera en 2005) mais aussi de l'espagnol Vincente Saez ou de l'allemand Christoph Winkler.
(2) Avec toujours une forte présence européenne, en provenance de France (Angelin Preljocaj, Claude Brumachon), d'Allemagne (Plischke), d'Italie (Montanile), d'Espagne (Linares), de Grande-Bretagne (Ladd), etc.
(3) Sénégal, Tunisie, Afrique du Sud, Kenya sont représentés au travers de personnalités professionnelles et d’artistes au sein du conseil d'administration, tout comme les festivals de danse "Dialogue de Corps" à Ougadougou (Burikina Faso), "Dense Danse" à Bamako (Mali), "Kaysech" (Sénégal), ou encore "Abok in Goma" à Yaouandé (Caméroun).
(4) C'est Maguy Marin qui fait "l'ouverture" en 2004 avec "Les Applaudissements ne se mangent pas", et débat avec le public ; ce sont Carolyn Carlson dansée par l'exceptionnel Yutaka Takei et Sidi Larbi Cherkaoui dansant « It » de Wim Vandekeybus ; ou encore Paco Decina et Toni Mira... En 2005 leur succèdent Tero Saarien, William Forsythe, le Ballet du Grand Théâtre de Génève, la compagnie Kafig, Francesca Lattuada, Catherine Diverrés,...
(5) Taoufik Izeddiou, Auman Abd El Fatah, Imed Jemaa, Hafiz Dhaou, Raddouane Meddeb, Imen Smaoui, Nawel Skandrani, Selma et Sofiene Ouissi, Ahmed Khemis,...
(6) Nigéria (Compagnie Ijodee), Mali (Ketty Noël), Ethiopie ("Agudana Dance Theatre"), Madagascar (Compagnie "Up the Rap"), Afrique du sud (Moeskesti Koena), Burikina Faso ("Ta" et Salia Ni Seydou), Sénégal (Germaine Acogny), Benin (Tchekpo Dan Agbetou), République Démocratique du Congo (Faustin Linyekula),...
(7) On citera parmi d’autres les présences d’Israel Galvan et Blanca Li (Espagne), de Raghumat Manet et Maria-Kiran (Inde), de Kô Murobushi et Tsuyoshi Shirai (Japon), Welisiwe Xaba (Afrique du Sud), Opiyo Okach (Kenya), Elsa Wolliaston (USA), Jérôme Bel (France)… Et encore Malek Sebaî, Nadia et Neyla Seijï, Haifa Bouzouita, Imed Jemaa (Tunisie)…
(8) Joëlle Bouvier, Jean-Claude Pambé-Wayack, Gilles Jobin, Pokeman Krew, Maguy Marin, Accrorap, Nacera Belaza, Hafiz Dhaou, Wanted Posse, Abou Lagraa,…sont au nombre des chorégraphes et des compagnies invités dans le cadre de cette édition. |